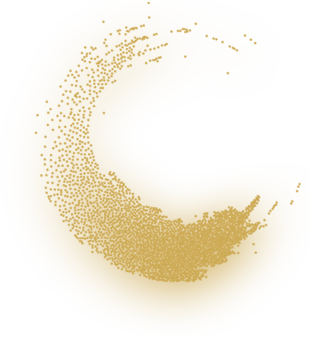VU : « Au Cœur » de Thierry Thieû Niang
Avant les dates parisiennes de Au cœur (les 23 et 24 octobre au Théâtre Châtelet), Thierry Thieû Niang a ouvert les portes d’une des répétitions au public. Cela se passait au CDC les Hivernales, à Avignon. Camille a assisté à celle-ci. Elle en livre un retour touchant, à la hauteur de la proposition artistique. En ce dimanche après-midi, nous étions tous Au cœur de quelque chose.
Au cœur ? Mais au cœur de qui ? De quoi ?
Tout commence par un jeune garçon qui erre au milieu des autres, par celui qui se sent étranger, qui n’est pas sûr d’être dans la bonne tribu. Il interroge du regard ces autres qui marchent tout autour et lui jettent, à leur tour, des coups d’œil en biais. Ça commence, ainsi, par le jeu de l’intrus.
Puis, tout s’accélère. Les jeunes gens se préparent, courent, s’élancent pour prendre leur envol, et retombent. Toujours. Lourdement. Bas. Tous ces corps sont étendus, comme échoués sur la scène. Cela ressemble à un champs de bataille où s’étend au sol le fol espoir d’Icare. La berceuse écrite par Camille (ndlr la chanteuse) s’élève doucement. De fragiles voix chantonnent comme pour apaiser : « dors, dooors ».
L’enfance est bien là, incarnée dans les corps et la chair, dans les signes disséminés tout autour de la scène. Des poupées, une grue, un 4×4, un ballon, des fleurs artificielles… Et les voilà, tous autant qu’ils sont, à jouer, chacun avec son accessoire. On a l’impression de voir des jouets mécaniques, des jouets à remonter, qui s’agitent en tout sens, le mécanisme rouillé en plus. Ce moment oscille entre des souvenirs de moments paisibles et le malaise de grandir. Si cette scène puise ses racines dans le monde de l’enfance, c’est pour mieux en montrer la vérité, celle d’un monde avec l’innocence en moins. Peut-être à l’image de cette enfant portée par les pieds, la tête en bas, les longs cheveux blonds traînent au sol entre les baskets du plus grand qui s’amuse avec cette poupée désarticulée.
Cependant, ils jouent à se déguiser, enfilant des habits tirés d’un tas en fond de scène. Tous revêtent les habits d’autres gens, des plus grands, des abîmés. Ces vêtements-là se tirent, se déforment sous la force des bras qui s’accrochent et s’agrippent dans les duos, dans les jeux de mains, dans les combats. Tee-shirts, pull, short, etc. recouvrent un à un une jeune fille, qui se change en montagne, en un monticule vivant de vêtements abandonnés.
Soudain, surgit une créature, vêtue d’une parka sombre, capuche serrée, et pantalon trop grand. La démarche tordue, le visage dissimulé. L’espace d’un instant, les monstres semblent s’être échappés des cauchemars de l’enfance, de ceux qui tendaient les traits et dessinaient des grimaces sur les visages assoupis, juste un peu plus tôt. Et la créature frappe la brouette qu’elle tire sur la scène. Et le bruit sourd et lourd retentit. Ce n’est plus un adolescent sous une parka, c’est l’Ankou [1] tirant sa charrette lugubre.
En fond de scène, les corps sont, rassemblés, en un tas, similaire au tas de vêtements du début de la représentation. Des jours sombres refont surface, par réminiscence. Ces jours où les corps ornés d’étoiles s’entassaient par milliers, ceux où les êtres échoués s’amoncellent sur les bords de plage, dans les villes assiégées. Et tous s’étendent à nouveau, et tous, relèvent doucement le t-shirt pour laisser apparaître la peau de la hanche. Les unes de la presse mondiale de ces dernières années s’incarnent sur scène.
L’histoire avait commencé en mettant en lumière le plus jeune. Elle s’achève sur la plus jeune qui égrène les mots du long et beau texte de Linda Lê. Un texte plein de mots compliqués, des mots d’adultes, où, le moment passé de la prouesse de l’enfant, on s’interroge. Sait-elle ce qu’elle dit ? Sait-elle combien elle chamboule l’âme en demandant « qui suis-je ? qui suis-je ? un oiseau aux ailes brisées ». À bien y regarder, oui, elle sait qu’elle raconte la douleur des exilés. « Et mon corps abandonné sur ce rivage ne se souvient même pas de la catastrophe ».
Me revient à l’esprit l’image marquante de cet enfant qui marche au milieu des êtres étendus. Je ne vois plus que le gamin que Victor Hugo faisait chanter sur les barricades : « ce n’était pas un enfant, ce n’était pas un homme, c’était un étrange gamin fée ». Ça y ressemble, le romanesque en moins. Parce que sur scène et dans la salle, on sait qu’il y a des corps allongés comme ceux-là, ailleurs que dans les romans.
La lumière vive de la salle nous renvoie à la réalité et les applaudissements retentissent. De larges sourires se dessinent sur les visages. Quel soulagement. Tout ça, c’était pour du jeu. C’était juste des enfants qui jouaient à l’amour, à la guerre, à la mort, à l’espoir. C’était juste des enfants qui incarnaient notre réalité.
Il reste de cette traversée une fascination du travail réalisé, le poids de la culpabilité de l’héritage qu’on laisse et tout à la fois, la certitude d’une lumière rayonnante qui réside en creux de ces jeunes. Toute la proposition est un va et vient entre le lumineux de ces êtres qui bougent, de ces airs concentrés, et l’épaisseur du malaise qui monte et des drames qui affleurent.
Alors au cœur de quoi ? De qui ? De l’enfance ? Des pensées des enfants ? De nos souvenirs ? De nos cœurs donc ? Au cœur de la vie et de la mort ? Au cœur du Jeu ?
Au cœur du monde alors.
Camille Vinatier - Ouvert aux publics - 16 octobre 2016 - Photo Jimmy Boury
[1] L’Ankou (en breton an Ankoù) est la personnification de la mort.
Voir en ligne : Retrouvez l’intégralité de cet article sur le site Ouvert aux publics
Représentations & évènements à venir
1er décembre 2024 28 décembre 2024
En répétition : Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient