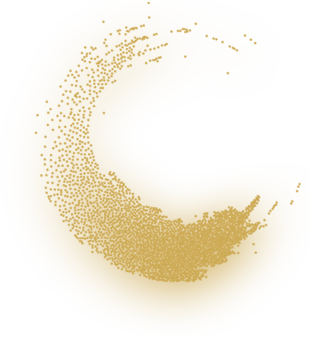Thierry Thieû Niang
Agapé
La MC93 et l’hôpital Avicenne s’associent pour la résidence artistique, dans le cadre du programme « Culture à l’hôpital », porté par la DRAC et l’ARS et mené par Thierry Thieû Niang, danseur et chorégraphe.
Les temps de cette résidence alternent des moments de présence, d’observation et de rencontres au sein des équipes et des ateliers de pratique du mouvement dansé avec les patients et les soignants.
Notes / Résidence à l’hôpital Avicenne à Bobigny / Automne 2019
Il y a Jean, 79 ans. c’est sa dernière séance de chimiothérapie et je suis resté avec lui trois heures de suite, et pendant plusieurs séances d’affilées.
Il aime parler, raconter. L’Espagne de son enfance, l’adolescence à Bagnolet, le Parti communiste et les amis italiens, arméniens et vietnamiens, Ferrat, la guerre d’Algérie, la menuiserie, les chantiers, les vacances à Madrid, le musée du Prado, le Greco et Picasso, ses petits fils qui le dépassent, les livres d’histoire qu’il lit chaque jour.
Son visage brille, ses yeux sont clairs et rien en lui n’exprime la peur ni la douleur. Ses bras sont agiles et dessinent dans l’air pour raconter encore et encore son enfance, son engagement. Il dit que sa femme est malade, en dépression depuis des années et qu’il ne la reconnaît plus, qu’il ne va plus la voir. Qu’il a ses fils et ses petits fils. Qu’il se bat toujours contre tout. Quelques gestes rapides et nerveux suffisent à changer la vie d’un homme.
Il s’en va debout, fier et alerte, coiffé d’une casquette, regardant devant lui.
Tout en lui est fait d’empreintes vives de l’histoire du monde.
La maladie est une expérience qui remet profondément en question le sentiment d’identité du sujet. Celui-ci ne sait plus qui il est, ne se reconnaît plus et est perdu dans sa propre vie. La maladie est une rupture dans la continuité de l’expérience humaine, une perturbation de la représentation de soi et du monde.
![]() Que peut-la danse ?
Que peut-la danse ?
Comment un mouvement dansé peut-il réparer l’image de soi ainsi dévastée ?
Pour répondre à ces questions, je vais aller respectueusement vers les patients, les familles, les soignants et les équipes et chercher avec eux un mouvement dansé fait de gestes simples et ouverts et dont le moindre frémissement est déjà une danse. Je vais esquisser avec eux ces gestes et échanger des paroles, des idées et des récits autour de l’histoire des corps - l’enfance, le désir, l’exil, la maladie - et ainsi accueillir tous les mouvements sensibles, uniques, empêchés, immobiles et fragiles - comme étrangers à soi, au monde, dedans, dehors.
C’est toujours dans un mouvement d’écoute, un geste de la main, un appui dans le dos ou simplement par un regard, que l’on peut se sentir renaître, exister. La douceur est retenue, la souffrance se tient à distance, la pudeur et la grâce s’épousent. C’est la vie telle quelle et rien d’autre.
" Un jour, on saura peut être qu’il n’y avait pas d’art mais seulement de la médecine."
J.M.G. Le Clézio
D’un geste dansé comme une allégorie de la présence à l’autre, ce projet veut explorer le thème de l’accueil, de l’écoute, de la présence et de l’étreinte – comprendre c’est prendre avec soi – en abordant la question du soin solidaire, social et intime.
Danser – soigner – c’est donner au patient le courage de dépasser la peur qu’il ressent devant un corps qui n’est plus le sien et qui lui incombe pourtant. C’est l’aider à habiter ce corps, d’en révéler un nouveau mouvement.
Il y a Mohamed, 39 ans, et ses tatouages faits en prison et qu’il voudrait effacer. La peau de ses bras et de ses pieds est irritée. Je demande à l’infirmière des crèmes. Elle dit que souvent on propose aux femmes pendant leurs traitements des séances autour du soin et qu’il lui est difficile d’approcher les hommes, de les conseiller, les inviter à participer à des séances de massage et autres soins. Sans mots je commence à masser les mains, les bras et les pieds avec les crèmes. Mohamed ferme les yeux, dit doucement merci. Plus tard il me montre le noyau de datte qu’il roule dans sa main ; il dit que lorsqu’on est malade, on peut utiliser un noyau ou une pierre et éviter de se mouiller pour la prière. Il me parle des jardins du clos St Lazare à Stains où il vit depuis vingt ans, de ses neveux dont il est fier, de la solitude qui le fait vomir. Je lui apporte un café avec deux sucres. Il dit qu’il regrette les bêtises, le temps perdu, et qu’il voudrait une autre vie.
Il me demande de l’accompagner dehors.
C’est la dernière séance. Il dit qu’il viendra me voir. Je souris. Lui qui viendra me voir à l’hôpital ! Ses gestes sont flottants et précis. La tête est tournée vers l’épaule gauche.
Sa main droite, paume vers le devant, ses doigts tendus semble arrêter quelque chose. L’autre main penche vers le bas, geste de protection et d’équilibre. Je le regarde. On dirait un naufragé qui sait que la fin est proche. Notre étreinte muette pour nous quitter me fait monter les larmes aux yeux.
Il y a les femmes et les hommes à égalité, celles et ceux en blanc et les autres. Des deux côtés. Comme deux rives avec un fleuve au milieu : la maladie qui coule, qui engloutit et qui emporte.
Les trop jeunes, les trop vieux, les amazones, les chevaliers. C’est bouleversant.
C’est toujours vivant et vrai.
À l’hôpital, tout est gestes et paroles.
Corps et récits.
C’est comme au théâtre.
C’est une voix qui appelle, qui rassure ; ce sont quelques pas dans le couloir que le soleil inonde ; c’est l’odeur du café ; ce sont les rires encourageants de Didier ; les regards bienveillants et discrets de Jérémie ; c’est la présence lumineuse de Jennifer ; celle vive et chantante de Lysiane ou encore l’écoute vertigineuse et sensible de Nacira ; toutes et tous, aides-soignants, infirmiers et médecins.
Encore, ce sont les sifflements graves des brancardiers et des chauffeurs de taxi, les arbres d’un jardin qui entoure les bâtiments de la cité que l’on voit dans le reflet des fenêtres ou encore un filet de musique ou d’une chanson qui s’échappe d’écouteurs posés sur un oreiller ou accrochés à la potence des perfusions. Sur ma blouse blanche en dessous de mes nom et prénom, il y a écrit danseur et chorégraphe.
Xu, 57 ans, ne comprend pas le français. Il sourit, il acquiesce tout le temps et les seuls mots en français que j’entends sont : merci, ça va, pipi et au revoir !
Je m’installe près de lui et je lui montre sur mon téléphone une photo où l’on me voit danser. Il rit. Puis, à son tour il me montre des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, une église en Chine où on le voit chanter et danser. Il porte une large croix en métal autour de son cou, et j’entends dans ça qu’il dit les mots de Jésus Christ et Maria ! Je ne comprends rien mais j’entends sa foi, sa joie.
Son regard s’illumine. On dirait qu’un de ses yeux pleure et que l’autre rit !
Sur son téléphone toujours il me montre une route qui passe par le Yunnan, le Vietnam et l’Allemagne !
L’infirmier me demande si je suis un peu chinois car c’est la première fois qu’il voit monsieur Xu si vif et communicatif !
Toutes ces semaines, comme un " wanderer", je vais marcher d’un lit à l’autre, écoutant les récits et les silences, accueillant les gestes et le plus petit des mouvements de ces femmes et de ces hommes. J’apporte un verre d’eau, un journal ou un crayon ; j’écoute une musique, un chant épaule contre épaule.
Je raconte mon métier, leur dis pourquoi je suis là auprès d’eux, avec eux.
Qu’être parmi eux c’est enrichir mon métier de danseur avec leurs mouvements et leurs gestes à eux. Qu’avec leurs mots, cette vulnérabilité partagée deviendra une force, une énergie nouvelle.
Il y a Edmonde, 85 ans, elle dit que c’est sa quarante deuxième séance et qu’il ne faut pas se plaindre, qu’il y a toujours pire. Son mari par exemple est lui aussi en traitement et que c’est plus pénible, plus fatiguant pour lui mais qu’elle est là et organise pour deux, qu’elle assure, qu’elle prépare tout, range tout, que déjà le repas est prêt pour tout à l’heure, qu’elle ne s’ennuie pas et qu’elle n’est pas fatiguée. Elle n’a jamais travaillé, juste aidé ses parents dans leur quincaillerie au Blanc-Mesnil où elle vit toujours. Elle répète une expression que je ne connaissais pas : ce sera pire que mieux ! Elle ajoute que la chose la plus difficile dans la vie est de perdre un enfant. Elle le sait, elle a perdu un de ces jumeaux de 46 ans.
Elle dit qu’elle n’a pas le temps de pleurer ; qu’il ne faut pas se plaindre : il y a pire et encore, ici tout le monde est gentil. Déjà, elle disparaît en trottinant dans le couloir ; son mari l’attend pour déjeuner.
La vulnérabilité nous invite, nous les « autres » à mettre en place des manières à faire face à cette fragilité pour la préserver. La tenir, la conserver au sens où cette fragilité peut être affaire de rareté, de beauté, de sensibilité extrême. De création de soi.
Danser c’est toucher et être touché.
Et comme le chantait Barbara : « Ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin... » et ce qui accable d’abord peut aussi par la grâce d’un geste ou d’un regard soulever quelque chose en soi.
Cela s’appelle chez Hubert Didi-Huberman : Un soulèvement !
Il y a Monsieur Koumé, 69 ans, professeur de sociologie en Côte d’Ivoire à la retraite, qui dit qu’il a peur, qu’il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit que s’il était resté dans son pays, il serait déjà mort. Il dit qu’il veut changer de lunettes et de dentiste. Profiter d’être à l’hôpital. Il y a tout ici. Il répète qu’il a peur. Qu’il n’a pas dormi la veille.
Le lendemain au kiosque dans le métro, je lui achète le magazine "Jeune Afrique". Je rencontre sa femme dans la salle d’attente qui me remercie. Elle dit que son mari m’attend.
Il me parle d’Abidjan et de l’université où ils ont enseigné, des danses traditionnelles de son pays, des mots de Bernard Dadié, poète de chez lui et il énumère des noms d’arbres dans la forêt de Chantilly et ceux du cimetière de Montparnasse. Je parle de Franz Fanon et de Aimé Césaire ; lui dis que mon nom de famille vient du Sénégal, que mon grand père était tirailleur envoyé en Indochine. Étonné, il me sourit. Nous évoquons la ville de St Louis, le quartier.
Il dit que la politique n’est plus aujourd’hui un horizon de poésie et de rêve ; que la politique ne représente plus un imaginaire pour le monde et que notre monde est devenu triste. Il dit qu’il faut ouvrir l’espérance. Je ne dis rien, je lui prends la main et lui dis merci. Un mois plus tard il me dit que je lui ai manqué ; qu’il est épuisé et qu’il veut rentrer au pays. Il dit qu’il a maigri et qu’il perd sa voix. Il dit qu’il ne veut plus revenir à Avicenne. Je veux lui lire un poème mais il secoue la tête et il dit qu’il veut dormir. Ses yeux pleurent.
L’hôpital est une ville, un pays, un monde.
Ce qui se passe à l’hôpital, c’est autre relève aussi de la création, du partage et de la passion. La souffrance, la peur, l’espoir, la gratitude d’un côté. L’écoute, l’intuition, la vigilance, l’attention, le temps de l’autre.
Ce que je vois et partage avec tous, c’est surtout qu’il n’y a plus de temps, pas assez de lits, plus assez de gens pour les malades, pour ceux qui débarquent avec leur douleur. Et la vie qui continue.
Je vais partager en public les 3 et 4 décembre prochains ces notes, ces gestes et ces danses accompagné entre autres par des soignants invités, les artistes Françoise Gillard, Nine D’Urso, Raoul Riva, Sébastien Amblard, Sipan Mouradian, Vincent Sauve et Jimmy Boury et Dounia, Pascal, Valentin, Adama, Jabir, Emmanuel, les adolescents de l’hôpital de jour.
Merci à celles et ceux qui m’accueillent :
Le service oncologie avec Isabelle Ribeiro
La maison de soin avec Lynda Belhia
Le service anti-douleur avec Elisabeth Collin
Le service pédopsychiatrie avec Michèle Sawaya et Olivier Taieb
Le service CSAPA - Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie / Boucebi avec Raphael Jeannin
Le service hématologie avec Françoise Judith
Merci à Marylène Litout et Margault Chavaroche.
Représentations & évènements à venir
1er décembre 2024 28 décembre 2024
En répétition : Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient