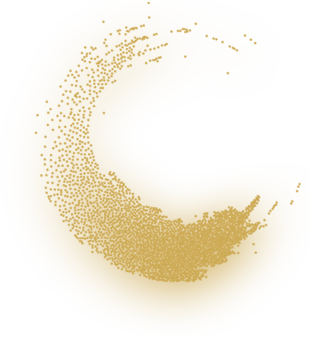Philippe Lançon
L’enfant qui va au jardin des Plantes sent que le monde est une zone habitée par des palétuviers d’appartement, des fleurs aux couleurs de jouet, des animaux puissants, amicaux et inquiétants : des choses et des bêtes à dormir debout que ce contrebandier en innocence cueille, grimpe et apprivoise aussitôt. Il le fait avec une imagination de pirate réprimé et une ingénuité menacée. Il a rejoint le lieu où la nature valse avec l’artifice, l’ordre avec la fantaisie et la rondeur des formes avec l’épaisseur du mystère. C’est tout l’univers de fougères en peluche et de totem à moustaches en guidon de vélo du Douanier Rousseau : la préhistoire au salon.
Prenons les Joyeux Farceurs, peints en 1906 et venus de Philadelphie. Près d’un étrange perroquet couleur crème aux allures de rapace qui lévite, cinq mammifères posés dans le vert nous regardent, de face, quatre devant et un derrière. Leur espèce n’est pas identifiable : ce sont des animaux dénaturés par la palette opiacée dont ils viennent. L’un d’eux tient du sanglier. Deux autres sont des jumeaux : Rousseau a du plaisir à peindre les jumeaux, qu’ils soient bestioles ou footballeurs, ils sont chez eux dans son inquiétante étrangeté, puisqu’à travers eux la nature bégayée et faussée imite l’art. Ils ont des airs de lion et de chien : des chimères peut-être domestiquées. Rousseau peint le « peut-être ». L’un sourit, l’autre fait la moue. Ils sont barbus, ils sont barbouzes, ils sont espiègles. A leur droite, dans les grandes herbes, une autre bête, noire et léonine, a des oreilles en pointe. Elle semble nettement plus méchante : son regard est celui d’un chat de Balthus. Le désagréable est comme une pointe d’amertume dans le sucré du tableau.
![]() Champignons mexicains
Champignons mexicains
Sous le menton des espiègles, deux objets insolites : un gratte-dos à main rouge et une bouteille renversée dont le lait s’écoule comme celui d’une burlesque tendresse humaine entre les langues de verdure. Le blanc renvoie peut-être, simplement, à la fleur aux multiples clochettes qui pend plus haut à droite, comme un lustre dans un salon bourgeois. Les feuilles des arbres sont pleines, rondes, sensuelles. Ce sont les joujoux de l’éternité. Le dernier animal, également entre chien et lion, sert de vigie : un Playmobil parmi les anthuriums, philodendrons, aristoloches, heliconias, yuccas, ananas et alpinias. Apollinaire écrit en 1908 qu’on est « agacé par la tranquillité de Rousseau. Il n’a aucune inquiétude, il est content, mais sans orgueil. Il n’aurait dû être qu’un artisan ». C’est qu’il entretient sa faune, sa flore, ses apparitions, ses tropiques et ses capricornes, avec ses outils de dompteur et de jardinier : il est l’artisan de son génie massif et encaustiqué.
Le visiteur parisien qui entre dans les salles qui lui sont consacrées au Musée d’Orsay devrait donc, avant de les ouvrir, fermer les yeux et, s’il y allait gamin, se rappeler les états dans lesquels il parcourait les serres et le zoo du jardin des Plantes. Ces états ne sont pas très éloignés de celui d’un consommateur de champignons mexicains, ce qui tombe bien, puisqu’une légende assure qu’Henri Rousseau, pendant son service militaire, participa à l’expédition de l’empereur Maximilien au Mexique. Cette légende n’est qu’une légende : le futur fonctionnaire à l’octroi resta en caserne en France et ne vit jamais le Mexique que dans les livres. Mais elle a été propagée par le plus grand poète de son époque, toujours Guillaume Apollinaire. Si ce voyage ne fut pas une réalité, il reste donc une vérité - celle d’un art qui le certifie : « Les tableaux que tu peins, tu les vis au Mexique. » Le vers du poète sur le peintre, également de 1908, figure dans la dixième et dernière salle de l’exposition, celle qui fait décoller vers les jungles pensives.
L’endroit est intitulé « La parade sauvage ». C’est une rotonde. Comme dans les salles précédentes, les murs sont d’un bleu reposant et la moquette, lie-de-vin. On croirait entendre tantôt Children’s Corner, tantôt l’Enfant et les sortilèges, tantôt la Bourrée fantasque de Chabrier. Deux petits tableaux servent d’aboyeurs en antichambre : Tigre et Lion, un Delacroix de 1858, et surtout la Rue des bois, une jungle verte et cubiste de Picasso de 1908, où la végétation est avalée par l’ombre qui en sort.
L’exposition, comme c’est devenu la mode, montre Rousseau dans son temps : influences et correspondances. Il y a donc des invités : Vallotton, Cézanne, Brauner, Seurat, Signac, Ensor, Picasso et bien d’autres, dont de surprenants anonymes ou méconnus Américains, comme un certain Path. Mais c’est le futuriste italien Carlo Carrà qui se taille avec ses œuvres au primitivisme insolent la part du lion jumeau. Comme presque toujours, les associations effectuées sont vraisemblables, même si rien ne justifie la plupart d’entre elles particulièrement. Les expositions sont devenues ce que sont les articles : d’intuitives caresses dont les frottements sont plus ou moins réussis. Orsay, bien sûr, utilise son fonds et quelques prêts du musée Picasso. Picasso, à son habitude, est agaçant : mis en position d’être comparé, il écrase tout le monde.
Outre les Joyeux Farceurs, six tableaux du Douanier occupent cette rotonde. Il y a des singes que le capitaine Haddock aurait sans doute formidablement injuriés. Il y a de splendides régimes de bananes qui n’auront pas mûri en cale. Des fauves mordillent une antilope à l’œil rond, un buffle endormi comme une femme de Renoir ou un cheval miraculeux : festin des yeux plus que des estomacs. Attardons-nous sur ce Cheval attaqué par un jaguar, qui date de 1910 et vient du musée Pouchkhine, à Moscou. Le canasson est gris clair. Ce qui attire l’attention est sa chevelure blanche : une délirante mise en plis ratée, aussi horizontale que verticale, qui en fait une licorne. Il a deux jambes à moitié en l’air. Le choc des deux bêtes est peint de telle façon que c’est lui qui semble, tout en nous regardant, mordre à la carotide le jaguar dont le visage est dissimulé. Partout autour, des fleurs vont jusqu’à la canopée. Chacune est solitaire, détachée du décor, installée comme une fleur asiatique en bois. Tout ce qui bouge et tout ce qui pousse est, chez Rousseau, isolé du décor, du temps, du mouvement. C’est son côté sapin de Noël et île de Pâques, sa statuaire en suspension. Sa fameuse luxuriance n’existe pas : c’est du côte à côte, et non de la prolifération. Sa non moins fameuse innocence est dans la distance, le détourage des êtres et des choses que dessine sa main joyeuse. Il a une adresse de garnement au jardin, une maladresse d’explorateur en chambre. Le ciel est par-dessus les arbres, si bleu, si calme.
Les salles précédentes donnent à voir comment l’artiste fut planté en son temps et hors du temps à travers des femmes aux allures d’hommes, des nourrissons monstrueux et sanglés comme au XVIe siècle, des soldats qu’on dirait de plomb, des bonhommes à redingotes qu’un objet rend déplacés, des paysages presque vides où aucune échelle, aucune vraisemblance n’est heureusement respectée. L’œil s’arrête sur les détails qui déboîtent le motif, et, comme on lisait jadis dans les mauvais romans, il frise. Les chefs-d’œuvre sont là : les extravagants footballeurs, deux paires de jumeaux moustachus qui dansent avant que la balle ait chu ; la Guerre, cette harpie enfantine sur son cheval noir qui pourrait être la jument verte.
Et bien sûr le Rêve, venu du MoMA, avant la dernière salle. C’est bien le centre de gravité de la nature refaite par l’art selon ce Rousseau-là : cet androgyne gris et envoûtant, aux hanches d’amphore recouverte d’un tissu psychédélique, ces deux lions hypnotisés si je ne m’abuse, cette Vénus Récamier au menton lourd, à poil, qui réplique Titien et Manet sur son divan parmi les fleurs géantes. Du serpent, on ne voit qu’un morceau, rose orangé, entre tentacule, pâte à modeler et tuyau d’arrosage. Si on cherchait bien, on trouverait peut-être dans un coin une oreille coupée, déposée par David Lynch. Il y a des oiseaux silencieux comme sur un perchoir, une mutine tête d’éléphant. A New York, le tableau est à quelques mètres de la Nuit étoilée de Van Gogh, devenu la Joconde de ce musée. Personne ou presque ne s’arrête donc pour entrer, comme Alice, dans le terrier tropical du Douanier. Les musées ne sont plus faits, hélas, pour Belphégor ni pour les somnambules.
Représentations & évènements à venir
25 février 2025 27 février 2025 à 20H00
Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient