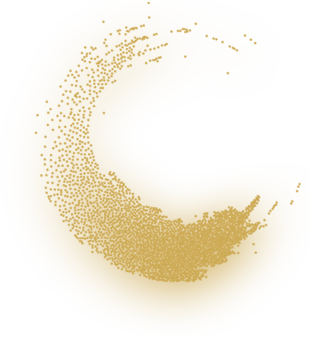Georges Didi-Huberman
« Les larmes sont une manifestation de la puissance politique »

Pour le philosophe et théoricien des images, le fait de pleurer est une façon de « porter plainte » et de s’emparer du pouvoir, pour ceux qui en sont fondamentalement privés.
Le plus souvent, les larmes sont privées, vues comme signe d’impuissance et de fragilité. Dans son dernier essai, Georges Didi-Huberman inverse la proposition : l’émotion devient partagée, le sanglot mène à l’action. Prémisse à la révolte, au soulèvement ? Au moment où le populisme suscite craintes et réprobations, le philosophe réhabilite à sa manière la puissance politique du sanglot et de l’image. Une analyse qui s’appuie, dans son dernier livre, Peuples en larmes, peuples en armes (éditions de Minuit), sur un exemple esthétique majeur : Le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein. Un homme meurt injustement, une femme pleure, les poings se lèvent. En octobre, les « peuples en larmes » feront l’objet d’une exposition au musée du Jeu de Paume, intitulée Soulèvements [1], dont Georges Didi-Huberman est le commissaire.
![]() Quels « peuples en larmes » avez-vous vus récemment ?
Quels « peuples en larmes » avez-vous vus récemment ?
Dès qu’il y a un soulèvement, il y a des émotions. Elles innervent alors tout le corps social. Je dirai même que, pour qu’il y ait soulèvement, il faut un partage des émotions - ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que cela suffit, politiquement et historiquement parlant. La tragédie analysée et reconstruite par Eisenstein dans Le Cuirassé Potemkine, que j’ai tenté d’analyser aussi précisément que possible dans mon livre, peut être vue comme un parfait exemple de cette situation. Un modèle, même. Il relève à la fois du « documentaire » et de la « poésie » : il doit beaucoup à des cas historiques précis, mais aussi à des élaborations littéraires telles que Les Misérables de Victor Hugo. Cette situation est la suivante : quelqu’un meurt de mort injuste. Un jeune homme, par exemple. Ou, pire encore, un enfant. Ou une femme. Ou une vieille personne, ou un groupe de civils désarmés. Cela s’est beaucoup vu, récemment, dans les révolutions arabes. L’émotion est alors à son comble. Elle est faite d’un sentiment d’horreur et d’indignation. Comment peut-on faire mourir un enfant, un jeune homme dans la force de l’âge - comme Mohamed Bouazizi en Tunisie, comme Vakoulintchouk dans le film d’Eisenstein ? On est accablé devant de telles « morts injustes ». Alors on pleure. Plus encore : on se lamente, comme il faut bien le dire dans des contextes religieux particuliers - le christianisme orthodoxe, dans le cas de la situation à Odessa en 1905, mise en scène par Eisenstein ; l’islam, dans le contexte de la Tunisie, de l’Egypte, de la Syrie contemporaines, ou encore le catholicisme en Amérique du Sud - qui ont pour charge de ritualiser la douleur.
![]() En quoi ces larmes publiques, collectives - alors que le pleur individuel relève de l’intime - ont-elles une dimension politique ? Y aurait-il, plus largement, une faculté critique de l’émotion ?
En quoi ces larmes publiques, collectives - alors que le pleur individuel relève de l’intime - ont-elles une dimension politique ? Y aurait-il, plus largement, une faculté critique de l’émotion ?
On peut pleurer tout seul, dans son lit, pour une raison personnelle, bien sûr. On peut aussi verser des larmes-alibi, des larmes de crocodile. Mais il arrive qu’on laisse simplement, sans l’avoir prévu, éclater ses sanglots devant autrui. Pleurer est intime - les larmes ne viennent-elles pas du dedans ? - mais pleurer, c’est aussi une façon de s’adresser à l’autre, de s’ouvrir à l’autre, puisque les larmes sortent de nos yeux et deviennent comme des petits éclats de cristal sur notre visage vu par l’autre. Pleurer nous défigure peut-être. Mais, en même temps, celui qui « perd contenance » en pleurant s’adresse à l’autre comme si ses larmes étaient les « amers » - vous savez, c’est le mot qui désigne, chez les marins, des points de repère dans la mer - de nos pensées, de nos désirs. La pure intimité, cela n’existe pas. On s’adresse toujours plus ou moins à un autre. Les anthropologues parlent de « rites piaculaires », c’est-à-dire de ritualités - et même de fêtes - fondées sur les larmes. Si l’acte de pleurer envoie un message, c’est celui d’une crise manifestée alentour. Pleurer peut donc - mais pas toujours, évidemment - avoir une résonance critique, donc politique.
![]() Les larmes ne sont-elles pas plutôt la manifestation de l’impuissance, souvent attribuée au féminin ?
Les larmes ne sont-elles pas plutôt la manifestation de l’impuissance, souvent attribuée au féminin ?
Quelle question ! Elle n’est pas très « politiquement correcte », vous ne trouvez pas ? J’essaye néanmoins de vous prendre au mot et de vous répondre. Mais pour cela, il me faut introduire une distinction très importante. Elle est cruciale, notamment, chez un philosophe tel que Gilles Deleuze, qui l’a développée dans le contexte de ses commentaires de Spinoza ou de Nietzsche. C’est la distinction entre puissance et pouvoir. Pleurer est sans doute une manifestation d’impouvoir : c’est souffrir, c’est subir. On « n’y peut rien ». Cela correspond à un mot grec qui se trouve partout dans les tragédies, le mot pathos. On ne prend pas le pouvoir, on ne l’exerce pas, les larmes aux yeux. Antigone pleure, pas Créon. Les femmes qui pleurent, dans les tragédies grecques - mais aussi dans Le Cuirassé Potemkine, dans la Tunisie en révolte, ou pensez également aux mères et aux grand-mères de la Plaza de Mayo, à Buenos Aires, qui ont réclamé des nouvelles de leurs enfants disparus avec une obstination extraordinaire -, toutes ces femmes n’avaient pas le pouvoir et ne cherchaient pas le pouvoir. Or leurs lamentations ont été d’une formidable puissance. Elles ont porté l’indignation à un point d’incandescence qui, devenu imprécation, appelle à faire justice, à se venger, à s’émanciper du tyran. Quand se plaindre devient porter plainte, alors commencent le soulèvement des peuples, le mouvement de l’émancipation, voire la révolution elle-même. Il se trouve que, dans de nombreux cas - dont celui admirablement raconté et théorisé par Eisenstein -, c’est une lamentation de femmes qui aura été le moment déclencheur d’une révolution. Voyez ces deux ou trois images d’Eisenstein : ici, c’est une femme qui pleure. Bientôt, c’est une autre qui arrache son voile. Enfin, c’est une jeune femme (en fait une militante du Bund, la grande organisation révolutionnaire juive de l’époque) qui lève le poing… Je réponds donc à votre question en vous disant que les larmes sont souvent une manifestation de la puissance politique de ceux ou celles qui manifestent depuis une situation fondamentale d’impouvoir.
![]() Vous dites qu’être affecté a un pouvoir émancipateur. Est-ce une façon de réhabiliter l’émotion du peuple via les images, aujourd’hui souvent opposée au logos ? Dans un climat de défiance vis-à-vis des émotions populaires, pourquoi vous intéresser aux larmes du peuple ?
Vous dites qu’être affecté a un pouvoir émancipateur. Est-ce une façon de réhabiliter l’émotion du peuple via les images, aujourd’hui souvent opposée au logos ? Dans un climat de défiance vis-à-vis des émotions populaires, pourquoi vous intéresser aux larmes du peuple ?
Il en est des émotions comme des images. Maurice Merleau-Ponty avait bien constaté ceci dans les années 60 : pour une bonne part de la pensée philosophique, « l’image est mal famée », disait-il. Il se référait à l’héritage, encore très vivace et quelquefois tyrannique, de Platon : l’image en général, ce ne serait ni plus ni moins que l’illusion, l’apparence, l’erreur, la croyance, la manipulation, etc. Toute vérité, dans cette optique-là, se construirait contre l’image. Je considère, de façon aristotélicienne, que les choses sont plus complexes que cela : à la fois plus concrètes et plus nuancées. Nous sommes, bien sûr, environnés et presque étouffés par des images qui nous mentent et nous manipulent. Mais cela ne dit rien de l’image en général, cela ne fait que constater la désastreuse valeur d’usage à laquelle les images sont le plus souvent soumises. C’est la même chose avec le langage : le langage n’est pas menteur en soi, ce sont les discours qui mentent. A la même époque, la langue allemande de Joseph Goebbels est menteuse, pas celle de Walter Benjamin ! Eh bien, c’est encore la même chose avec les émotions. Ce qui doit être critiqué, c’est un certain usage - voire un certain marché médiatique - des émotions. On se tromperait à vouloir liquider « les émotions » de la sphère politique parce qu’elles sont manipulées ou manipulables. Faire de la politique en croyant éliminer l’élément émotionnel sous prétexte que les émotions forment le matériau principal des populismes, c’est comme entretenir une relation avec quelqu’un en voulant éliminer l’amour sous prétexte que la pornographie a déjà fait son trivial marché… Ce que je veux dire, c’est qu’on ne doit pas abandonner à son ennemi politique ces choses aussi précieuses et aussi profondes - anthropologiquement parlant - que sont les images ou les émotions. Il faut les repenser à travers de nouvelles valeurs d’usage.
![]() Une révolte par les larmes est-elle possible ? Eisenstein liait, selon vous, émancipation politique et romantisme…
Une révolte par les larmes est-elle possible ? Eisenstein liait, selon vous, émancipation politique et romantisme…
Évidemment cela ne suffit pas. C’est pour cela que je vous ai parlé tout à l’heure de la nécessité de porter plainte au-delà du seul fait de se plaindre. Maintenant, je n’emploierais pas la catégorie du « romantisme » comme un style artistique susceptible d’être dépassé, comme dans le schéma des « régimes » proposé par Jacques Rancière. La lecture de Freud et de Warburg m’a convaincu que, dans la sphère des cultures et des actions humaines, rien n’est obsolète : tout est survivant. Tous les problèmes se reposent à nouveaux frais mais à partir de répétitions, de mémoires enfouies, de retours du refoulé… Il y a donc un « romantisme révolutionnaire » très actuel, qui porte en lui, certainement, quelque part, la mémoire de ces enthousiasmes profonds que l’on trouve chez Eisenstein, Brecht, Benjamin ou Ernst Bloch… L’heure semble être au pessimisme, je le sais bien. Mais Benjamin disait ceci, qui est tellement précieux et porteur de futur : « Organiser le pessimisme signifie… dans l’espace de la conduite politique… découvrir un espace d’images… ». À nous de le découvrir, cet « espace d’images », et, surtout, d’en faire bon usage.
Par Catherine Calvet et Cécile Daumas - Libération - 1er septembre 2016 / Extrait du « Cuirassé Potemkine » d’Eisentein - 1925 - Photo Goskino-Mosfilm
[1] Musée Jeu de Paume, du 18 octobre 2016 au 15 janvier 2017, Paris.
Voir en ligne : Retrouvez cet entretien sur le site Libération
Représentations & évènements à venir
25 février 2025 27 février 2025 à 20H00
Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient