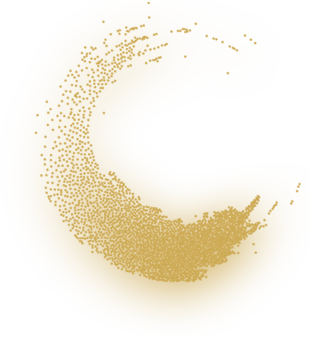Là où ça fait mal
Elle est seule sur l’immense plateau noir. Un gilet de laine serré sur une jupe sans forme ; juste un manteau strict quand elle part soudain courir la ville ; les cheveux longs, blond-roux, qui pendent d’abord, puis sont ramassés en chignon ; le visage constamment défait, pâle à mourir. Elle attend. Elle attend désespérément son homme expédié par les nazis à Dachau. Elle le croit mort, pourtant. Mais elle attend. Elle, c’est Marguerite Duras, incarnée par Dominique Blanc dans la mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang. Mais la locution même de « mise en scène » ne convient pas, tant, les premières minutes exceptées, le spectacle - encore un mot ici presque obscène - est une invitation au recueillement, à la conscience et au dépassement de l’épouvante. Les premières minutes exceptées ?
Parce qu’on y voit Dominique-Marguerite vider convulsivement son sac, en ranger, déranger, reranger le pauvre contenu d’écrivain (crayons, cahiers) sur un petit bureau. Et que toute cette frénésie-là fait tout à coup trop « théâtre », alors que la direction de l’actrice, son interprétation vont peu à peu nous conduire bien au-delà de tout artifice. Dans un no man’s land de douleur absolue, d’espérance absolue, et d’humanité radicale et essentielle. Comme une prière laïque, un Livre de Job des temps modernes.
Au moment de la publication de ce texte, en 1985 (avec d’autres sur les années d’Occupation), sous le titre La Douleur, Duras avait dit avoir oublié ce journal tenu au coeur de la guerre, et déposé dans une armoire de sa maison de Neauphle-le-Château. Et elle s’interrogeait sur cet invraisemblable oubli d’un des épisodes les plus atroces de son existence : l’absence insupportable d’un homme capital pour elle, puis son effrayant retour et sa lente renaissance.
Comment peut-on néantiser pareille douleur ?
Comme malgré elle, Duras se retrouvait dans la peau de certaines de ses héroïnes, lourdes d’un passé indicible qu’elles tuent lentement - jusqu’à la folie parfois, ou au crime - faute de pouvoir l’assumer. La tragique Marguerite de La Douleur ne mourra pas de chagrin, telle son homonyme aux camélias, dont elle partage l’attente et le lamento. Portée par Dominique Blanc, c’est une femme forte. Trop de souffrance tue la souffrance. C’est une femme capable de tout affronter, parce qu’elle est à nu et nue d’illusions. L’actrice glisse dans l’espace. Sept chaises à gauche, une table et deux chaises à droite. On se souvient à peine de ses gestes (sauf l’hystérie du début) tant son esprit possède son corps, tant sa pensée est devenue peau, et sa voix, concrète. Pouvoir et grâce de la direction de Patrice Chéreau ?
Les deux artistes se connaissent depuis 1981, et l’on sait l’attachement amoureux du metteur en scène à certains de ses comédiens. La connivence ici est parfaite. Sans qu’on veuille même savoir qui est responsable de quoi. Quand elle raconte la remontée des ténèbres de l’homme aimé, quand elle décrit crûment sa merde verte et bouillonnante qui progressivement changera de couleur et reviendra à la normale, pas moyen d’être dégoûté ou choqué : on regarde avec elle au fond du seau. Avec la même inquiétude, la même passion. Et ce sont ces instants-là, sans doute les plus puissants du « spectacle » : que l’actrice, que ses metteurs en scène nous conduisent à imaginer les signes de vie les plus bruts avec autant de respect. La Douleur est un cri déchirant à l’amour de la vie. Envers et contre tous. Contre l’horreur nazie. Contre l’atrocité ordinaire. Contre nous, aussi.
Fabienne Pascaud - Décembre 2008
Représentations & évènements à venir
25 février 2025 27 février 2025 à 20H00
Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient