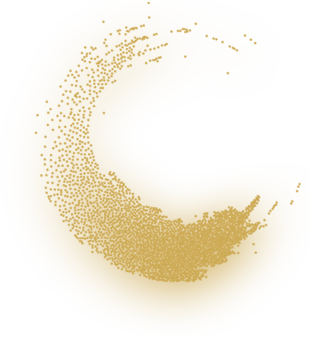« Grand Palais » : un modèle et son peintre
Retour de palais... pour Bacon, la muse, le bourreau et le sybillin
« En octobre 1971, une grande rétrospective de l’œuvre de Francis Bacon a lieu au Grand Palais à Paris − avec, sur nombre de toiles, une figure masculine, celle de George Dyer, qui fut l’amant et modèle du peintre britannique. Le public, qui le découvre via les tableaux, ignore qu’il s’est suicidé deux jours avant l’inauguration, dans les toilettes de leur luxueuse chambre d’hôtel. Grand Palais est la rencontre des écritures de Julien Gaillard et Frédéric Vossier, habitant chacun les sensibilités et langages si différents de Bacon et Dyer. Pascal Kirsch met en scène, avec trois acteurs et un musicien, ces paysages mentaux peuplés de corps, de sensations, d’images indélébiles par-delà la mort. »
Le plateau est habité par un mur-miroir réfléchissant, mécanique de la déformation, de la métamorphose. La lumière diffracte cette surface lisse, quatre panneaux pourraient déjà évoquer les toiles de Bacon, souvent exposées en triptyque à la verticale... Le personnage qui se profile sur ce tapis rouge en frontal qui crisse sous ses pas, est celui du peintre qui s’interroge sur le phénomène des images, des icônes. Son travail en quelque sorte. Une silhouette s’invente comme un spectre dans cet univers étrange traversé par l’évocation des peintres mentors de Bacon. Appuyés par des images surdimensionnées en vidéo de leurs œuvres. Hanté par ses maitres, le voilà aux prises avec son modèle, amant turbulent qui fait irruption dans son monde fantasque et pervers. Ce n’est pas vraiment de l’empathie que l’on ressent à son égard, homme farouche, implacable maitre et autoritaire artiste démiurge. Ne pas « déranger » son ordre de perversion, de flatterie face à un être qui souffre, qui se meurt dans l’âme et qui hurle sa douleur et son manque d’amour. Arthur Naucyciel s’y colle à ce tyran toxique qui jouit de son pouvoir, de sa célébrité au détriment de sa muse. Dahlias à la boutonnière et autres atours séducteurs en main. Bourreau de cœur et d’âme à l’envi. Ses gestes sont pourtant calmes, ouverts à l’abri de tout soupçon, libres et quasi gracieux... Alors que près de lui ou dans l’ombre se meut son amant Georges Dyer incarné par Vincent Dissez, perturbé, en déséquilibre inquiétant. Le corps accueillant la chorégraphie tranquille signée Thierry Thieû Niang qui comme a son habitude respecte morphologie et capacité des comédiens pour accentuer leurs qualités de gestes, les conduire vers un inconnu insoupçonné de leur talent, de leur présence. Ainsi un pas de deux frontal, duo sans contact, parallélisme où la gestuelle diverge : l’un gracile et ondoyant, à l’aise, l’autre encore crispé par la certitude d’être le meilleur, le célèbre au firmament de la critique. Convoquant sempiternellement son maitre Eadweard Muybridge pour ses recherches sur la « Locomotion » ce qui émeut et met en marche, en mouvement, tout corps humain ou animal. Des images en vidéo projetées pour illustrer cette obsession artistique, modèle ou référence redondante. Le texte pour souligner cette dichotomie, cet écart entre les deux personnages, tissé à quatre mains par Julien Gaillard et Frédéric Vossier : composition quasi musicale où les deux écritures se mêlent et se confondent. Quant à un autre personnage, la musique, elle se fait discrète autant qu’omniprésente sous les doigts d’une guitare cachée, dissimulée aux regards du spectateur. C’est Richard Comte qui improvise ou se colle aux failles rythmiques du texte pour s’immiscer dans cette atmosphère glauque, ce chant de douleur ou d’amour. Avec mesure ou démesure, lyrisme dissimulé ou élégance convoquée comme une danse à fleur de peau. La scénographie magnifie la métamorphose des corps en reflets mécaniques sur la surface concave ou convexe de la paroi miroitante. Comme les corps des personnages peints de Bacon qui mutent, assis sur des socles ou « cabinet » eux aussi aux formes molles improbables supports d’appui. Danse et mise en mouvement singuliers pour ces acteurs imbus de leurs personnages parfois agaçants, odieux. Pascal Kirsch opérant pour le flou, la galbe des courbes plastiques et picturales, le trouble qui se déplace et se transforme à l’envi sous nos yeux. Ce « grand palais » comme un retour en bouche, un gout, des saveurs amères ou acides, une atmosphère loin de la fête même si beuverie et extravagance, excès et bavures illimitées jonchent l’univers de ces créatures pas toujours de rêve. Un Sibyllin, Guillaume Costanza comme pour commenter à la façon du chœur les us et coutumes de ces deux protagonistes du « mal » être. Un Sibyllin est un adjectif utilisé pour définir un discours ou un texte qui est difficile à comprendre. Cela peut être mystérieux ou trop complexe... Une pièce extra-ordinaire comme son propos où évoquer Bacon est un challenge, un exercice de style et de forme à la limite de l’impossible... De l’incertain de ses compositions picturales, triptyque insaisissable de la matière corporelle jouissive. Gravir les marches du Grand Palais : un pari gagné sans dérouler le tapis rouge.
Aiguiser le Palais et lui ôter son voile pour mieux chanter !
Geneviève Charras - L’amuse-danse ! - 11 mars 2023
Voir en ligne : Retrouvez cet article sur le blog de Geneviève Charras
Représentations & évènements à venir
1er décembre 2024 28 décembre 2024
En répétition : Ovni rêveur, le corps éparpillé dans la têteThéâtre de Lorient