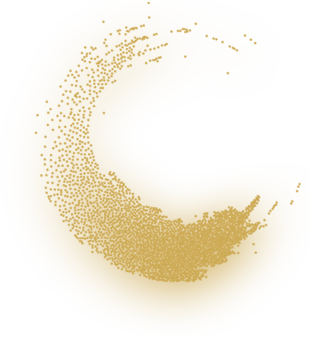Une contribution de Georges Didi-Huberman
La vie est à nous. Hériter, espérer, sortir de soi.

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament »… L’aphorisme de René Char, revisité par Hannah Arendt dans La Crise de la culture (Gallimard, 1972), nous demande de repenser ensemble l’autrefois, le maintenant et l’après de toute transmission. C’est que toute transmission se révèle problématique : incomprise ou incomplète, ou ambivalente, ou trop exigeante, ou trop évidente, ou que sais-je encore. Elle est donc à constamment retravailler.
Comment se déploie une transmission lorsqu’elle se révèle, non pas « manquée » au sens strict (c’est-à-dire forclose à jamais), mais simplement marquée par l’innommé ? Ne faut-il pas compter avec ceci que le passé refoulé finit toujours par faire retour à travers symptômes, crises ou séismes de notre présent ? Comment donc se constitue une tradition lorsque son contenu, héritage du passé, nous vient de grands-parents trop mystérieux ou de trésors incompréhensibles qui se retrouvent, sans qu’on les ait choisis, entre nos mains, au fond de notre cœur ou juste sous nos pieds ?
Notre héritage, nos trésors insus : comment donc les remettre au travail en vue de ce que nos désirs les plus criants, les plus actuels, ne réussissent pas encore à formuler clairement ? Il faudrait d’abord accepter de s’enfoncer dans la forêt – sans chemins bien tracés, sans horizons salvateurs –, la forêt de nos mémoires. Inventer, au sens archéologique du verbe, la matérialité de nos trésors transmis. Creuser le temps, ou les temps enchevêtrés, de nos histoires insues. Nommer ou renommer les fantômes de nos ancêtres dont les sépultures ont disparu ou n’ont plus de sens lisible, surchargées qu’elles peuvent être par le bric-à-brac prescriptif des « devoirs de mémoire ».
Hériter, et après ? Eh bien, après, réimaginons nos trésors passés en vue de nos espérances les plus fondamentales, les plus urgentes et actuelles.
Il faudrait ensuite se mettre à la table – et, en écrivant ce mot, je pense d’abord à la planche de bois sur laquelle Goya conçut son célèbre Caprice sur le « songe de la raison » (1799), je pense aussi aux planches de montages photographiques qu’Aby Warburg (1866-1929) composa à partir des documents visuels de la longue histoire de gestes –, la table de nos imaginations.
L’imagination recompose nos héritages, redistribue les trésors de notre mémoire. Elle les recompose en les composant avec l’urgence même de nos inquiétudes présentes. Alors l’anamnèse devient prise de position, comme on le voit si clairement dans les œuvres – parmi d’autres – de Marc Bloch ou de Walter Benjamin, d’Ernst Bloch ou de Cornelius Castoriadis, de W. G. Sebald ou de Pierre Guyotat, de Pier Paolo Pasolini ou de Glauber Rocha… L’imagination n’est pas la fantaisie gratuite ou purement personnelle, mais bien cette recomposition du réel où s’inventent les possibles à venir. Hériter, et après ? Eh bien, après, réimaginons nos trésors passés en vue de nos espérances les plus fondamentales, les plus urgentes et actuelles.
Il faudrait enfin que tout cela ouvre grand nos horizons : les horizons que dessinent nos désirs. Car ce sont les désirs qui, en dernière analyse, mènent la danse de l’histoire. Désirer, c’est ouvrir. C’est s’ouvrir à l’autre, aux autres. Voilà qui pose, en fin de compte, la question éthique et politique en tant que telle (comme Jacques Lacan l’avait bien compris en commentant l’histoire d’Antigone selon le double point de vue du désir et de l’éthique).
Désirer, c’est ouvrir : on ne transformera donc son héritage en désir qu’en s’ouvrant à l’autre, c’est-à-dire en sortant de soi-même. Je ne ferai rien de bon de mon trésor hérité si je le garde pour moi-même. La seule chose à faire d’un héritage, ce serait donc de le partager et de le transmettre à d’autres : cela même qui nous permettra, depuis l’héritage, d’espérer et de faire espérer. De viser un futur, de faire fructifier le temps. Privatiser un héritage, quelle misère ! Quelle mort pour l’après !
Après avoir reconnu et nommé notre héritage – par anamnèse et recomposition imaginative –, voici donc qu’il nous échoit de le partager, de le transmettre. Ce qui veut dire : ouvrir le sujet, ouvrir le « je ». Mais de quelle façon penser un tel partage ? Commençons par reconnaître que chacune de nos pensées, paroles, émotions, gestualités, formes ou actions est assumée par un « je », élargie et discutée par un « tu », proposée et modifiée par « il » ou « elle », mise en commun par « nous » pour être expérimentée avec « vous », « ils » et « elles ». Levons alors l’équivoque liée au « subjectivisme » tant dénigré (quand il n’est pas instrumentalisé) des émotions ou des gestualités politiques. Il faudrait, de Spinoza à Freud et au-delà, reconsidérer ce que « sujet » veut dire et ne pas confondre ce mot avec l’unique personne qui nous laisse penser qu’elle est propriétaire de ses émotions comme de ses pensées : « je » contre « tu », par exemple, ou « nous » contre « vous ». Ce n’est pas à « désubjectiviser » l’éthique ou la politique qu’il faut travailler, mais à les « dépersonnaliser ». Ce qu’il faudrait, en somme, c’est soulever le sujet.
Il y a – il y aura toujours – une multitude de genres possibles pour ce « nous » crucial et problématique, ce « nous » à constamment réinstaurer. Le « nous » ne se présuppose pas, il s’invente et s’organise. Avec plus ou moins de rapidité, de spontanéité, de directivité, de génie pour les formes. Car ce sont bien, ici encore, des formes qui rendront sensible la puissance du désir en nous, ce désir qui sort de nous, nous soulève et nous fait sortir de nous.
Contre l’idée d’une « forme de vie donnée au peuple » par ceux qui entendent le gouverner – en réalité : l’exploiter jusqu’à la moelle –, le peuple répondra donc : la vie est à nous. Phrase qui exprime exactement le désir, l’exigence que nous nous donnions à nous-mêmes les formes de notre vie. La vie est à nous, cela veut dire la liberté et l’autonomie, tout simplement : notre vie n’appartient pas à ceux qui nous font travailler. Notre liberté consiste à juger par nous-mêmes ce que seraient une bonne durée et de bonnes conditions pour tel ou tel travail, enjeu – celui du droit du travail, du droit politique en général – qui traverse tout le film de Jean Renoir et de ses amis justement intitulé La vie est à nous (1936). Nous héritons de la vie, c’est certain. Mais la vie n’a de sens que si « la vie est à nous » : tâche complexe dans l’ordre éthique et politique. Tâche de toute une vie, et même au-delà, pour construire les possibilités d’une liberté de chacun.
Hériter, et après ? Il suffit donc – mais comme c’est difficile ! – de « saisir cette chance » de liberté, comme disait Walter Benjamin, « pour arracher une époque déterminée au cours homogène de l’histoire » des vainqueurs. Cela pourrait s’appeler un soulèvement du temps.
Georges Didi-Huberman (Philosophe) - Le Monde - 27 octobre 2016 - Illustration Aline Bureau